Pour Une École Qui Écoute, Protège Et Accompagne Chaque Jeune
Je me souviens précisément du moment où j’ai lu le récit de ce drame, survenu dans un établissement scolaire. J’ai senti un frisson parcourir mon dos, cette sensation d’impuissance mêlée à une colère douce, contenue, mais tenace. Comment avons-nous pu en arriver là ? Comment expliquer qu’un·e élève, un·e jeune en souffrance, passe à l’acte sans que personne ne l’ait vu venir, ou du moins, sans que la société lui ait proposé d’autres voies que celles de la douleur et de l’isolement ? Ce sujet me touche profondément car, depuis des années, je défends une éducation plus humaine, plus douce, plus proche des réalités affectives de nos enfants.
À chaque fois qu’un tel drame secoue l’opinion, les réactions des autorités suivent un scénario désormais tristement prévisible. Des annonces rapides, spectaculaires, des décisions fortes sur le papier : interdiction de la vente de certains objets, installation de portiques de sécurité à l’entrée des lycées, renforcement de la présence policière. Je comprends la nécessité de répondre à l’émotion, mais je ne peux m’empêcher de penser que ces mesures relèvent davantage du réflexe politique que d’une réflexion de fond. Elles ne disent rien de la détresse silencieuse, elles ne soignent pas les causes profondes. Elles rassurent, peut-être, mais ne réparent rien.
Quand je découvre les chiffres les plus récents, je ressens une angoisse sourde. Une augmentation de 32 % des soins psychiatriques chez les jeunes de 5 à 19 ans entre 2020 et 2024. Treize pour cent des enfants de 6 à 11 ans souffrent probablement de troubles mentaux. Et nous ne parlons même pas ici des jeunes qui restent invisibles, silencieux, ceux dont la souffrance ne franchit jamais les portes du cabinet médical. Je pense à cette adolescente croisée dans un couloir de collège, tête baissée, épaules rentrées, invisible au regard des adultes trop pressés. Et je me demande : qui l’écoute, vraiment ?
Je suis convaincue que nous devons changer notre regard, changer de posture. Réagir à la violence par la sécurité, c’est ignorer que la racine du problème est souvent intérieure. Il faut apprendre à voir les signaux faibles, à écouter les silences, à entourer plutôt qu’à contrôler. Ce dont les jeunes ont besoin, c’est d’un environnement bienveillant, attentif, dans lequel ils peuvent se sentir reconnu·e·s, compris·e·s, soutenu·e·s. C’est de là que naît la confiance. Et c’est de là que nous devons repartir.
J’imagine une école où chaque élève a accès à une cellule d’écoute, animée par un·e professionnel·le formé·e, et non simplement par un·e adulte de bonne volonté. Un lieu où les enseignant·e·s, régulièrement formé·e·s à la détection du mal-être, peuvent alerter sans crainte, et avec efficacité. Une école où des rendez-vous sont prévus non pas seulement pour évaluer des compétences, mais pour évaluer le bien-être, l’équilibre intérieur. J’ai connu des élèves qui portaient leur chagrin comme un sac à dos invisible, et il aurait suffi d’un geste, d’un regard, d’un rendez-vous avec une oreille attentive, pour que ce poids devienne partageable.
Je rêve aussi d’une éducation qui donne toute sa place aux émotions. Apprendre à nommer ses peurs, ses joies, ses colères, c’est apprendre à être soi. J’aurais aimé, moi aussi, participer à ces ateliers où l’on parle de soi sans être noté·e. Des cercles de parole, des débats philo, des jeux coopératifs autour de l’empathie. Ces compétences, que l’on relègue trop souvent au second plan, sont pourtant les premières à nous structurer. Elles permettent aux enfants et aux adolescent·e·s de traverser les tempêtes de la vie avec un peu plus de solidité.
Mais l’école ne peut pas tout. Elle a besoin de relais. Je pense à cette maman rencontrée lors d’un atelier parents-professeurs dans un quartier populaire : elle était inquiète, perdue, honteuse de ne pas savoir quoi faire face à la tristesse de son fils. Elle n’avait jamais été invitée à parler, à participer, à comprendre ce qui se jouait à l’école. Nous devons créer ces espaces d’alliance, où les familles sont vues comme des partenaires et non comme des obstacles. Il y a tant de ressources dans les quartiers, dans les associations, chez les éducateurs et éducatrices de rue, qui pourraient faire lien avec les établissements.
Et pour que cette mobilisation soit efficace, elle doit être suivie, mesurée, consolidée dans la durée. Trop souvent, je vois des projets prometteurs s’essouffler faute de pilotage ou d’évaluation. Pourquoi ne pas instaurer des cahiers de bien-être anonymes, des cercles mensuels entre élèves et adultes, des retours réguliers sur les ressentis des jeunes ? Ces outils simples permettraient d’ajuster, de redonner du sens, de maintenir vivante l’ambition d’une école vraiment humaine.
Je me demande souvent quel rôle je peux jouer. J’écris, je témoigne, je partage. Mais je ressens parfois le besoin d’agir davantage, d’intervenir sur le terrain, de co-construire avec d’autres femmes, d’autres éducateurs et éducatrices, des espaces de parole, de soutien, de reliance. Une phrase, lue récemment dans un rapport du HCFEA, m’a profondément marquée : « les jeunes ne sont pas les causes de la violence, mais souvent ses premières victimes silencieuses » ([Source]). Cette idée ne me quitte plus.
Alors j’aimerais terminer sur une promesse. Celle d’une école où l’on veille les un·e·s sur les autres, où les élèves ne grandissent pas seuls avec leur peine, où les adultes sont présents, disponibles, formé·e·s. Une école qui n’ajoute pas de murs, mais tisse des ponts. Une école qui se donne pour mission de protéger autant que d’instruire. Et si l’on faisait de nos écoles des refuges de confiance, pour qu’aucun·e élève ne grandisse dans l’ombre de son chagrin ?




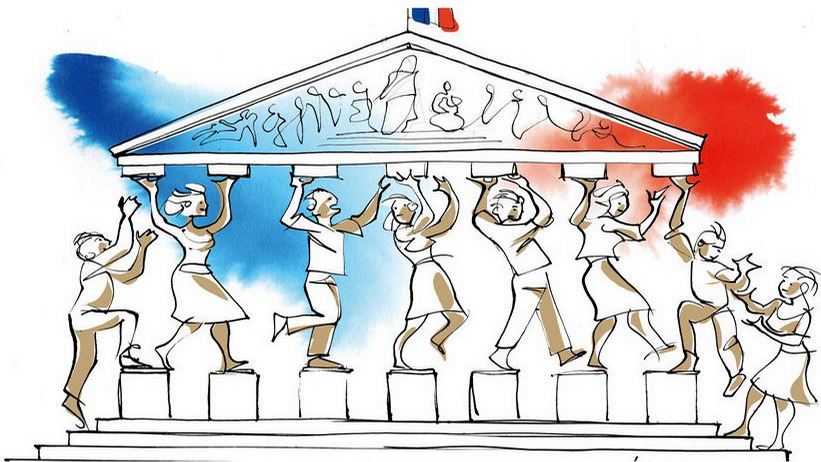


Laisser un commentaire